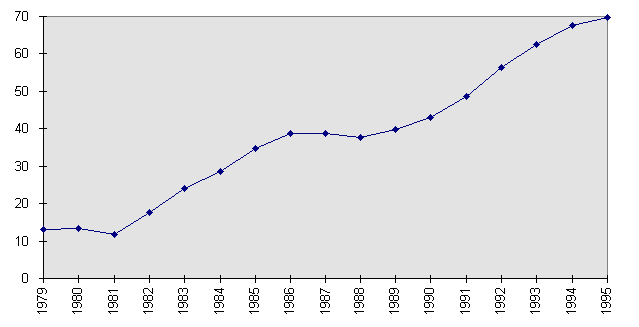
Un changement important de la décennie 90 a été l’abandon, à toutes fins utiles, de l’un des rôles traditionnels de la politique budgétaire canadienne, à savoir la stabilisation du cycle des affaires (lire l’encadré sur Comment lire un budget). Alors que la récession de 1981-1982 avait incité le gouvernement à délier les cordons de la bourse afin de soutenir la production et l’emploi, la récession de 1990-1991 a plutôt donné suite à des compressions budgétaires comme les Canadiens n’en avaient pas vu depuis fort longtemps. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les entreprises aient eu à apprivoiser une réalité à la fois nouvelle et difficile : un consommateur craintif pour son emploi et cherchant à tirer le meilleur parti d’un revenu dont le pouvoir d’achat, une fois les impôts payés, diminue année après année. La grande question est : nos gouvernements avaient-ils le choix ?
Une contrainte budgétaire implacable
De bonnes intentions mais un endettement chronique
Les programmes mis en place par nos gouvernements au cours des années ont généralement visé à atteindre des objectifs louables. La croissance rapide et soutenue des années 60 et 70 facilitait grandement les choses puisque le financement de ces programmes semblait se faire sans sacrifices. Les habitudes interventionnistes se sont établies sans que l’on ne prenne note des changements importants qui commençaient à se manifester dès le milieu des années 70. Alors que s’aplatissait le sentier de croissance à long terme, les gouvernements, tant provinciaux que fédéral, continuaient de multiplier les initiatives. Les déficits temporaires cédaient le pas aux déficits chroniques et les récessions, temporaires par définition, avaient un impact permanent sur les finances publiques.
Des risques d’insolvabilité à long terme
Tout déficit budgétaire mène à l’emprunt et à l’accumulation d’une dette. Ce n’est pas la dette absolue à proprement parler qui inquiète les marchés financiers mais plutôt la relation entre la dette et le produit intérieur brut (PIB). La dette fédérale canadienne est nettement inférieure à la dette fédérale américaine et pourtant le problème de l’endettement est plus aigu au Canada qu’aux États-Unis, parce que le PIB canadien est moins élevé que le PIB américain.
Puisque le PIB correspond à la totalité des revenus générés dans l’économie domestique, il représente la matière taxable à laquelle les gouvernements peuvent puiser pour financer le service de la dette. Comme on
Comment l’économiste lit-il le budget? Qu’y cherche-t-il? Dans une perspective de court terme, il y cherche des données qui l’informent des effets probables du budget sur le cycle des affaires et la création d’emplois. Dans une perspective de long terme, il s’intéresse à l’effet du budget sur la situation financière du gouvernement et la tendance à long terme de l’économie. Un budget peut atténuer le cycle des affaires; il peut aussi influencer la croissance tendancielle de l’économie. Il se peut donc qu’un budget orienté vers la stabilisation à court terme de l’économie soit contre-indiqué du point de vue de la tendance à long terme de l’économie.
L’économiste porte une attention spéciale au solde budgétaire. Il lui sert d’indicateur de la politique de stabilisation. Une politique expansionniste (réduction d’impôts, hausse des dépenses) gonfle le déficit budgétaire et stimule la production et l’emploi. Une politique restrictive (hausse des impôts, réduction des dépenses) réduit le déficit, freine la production et l’emploi. Mais le solde budgétaire est un indicateur imparfait parce qu’il est influencé par le cycle des affaires. Une hausse du déficit peut être due à une récession tout autant qu’à une politique expansionniste. Une baisse du déficit peut résulter d’une politique restrictive ou d’une expansion de l’économie. Selon les documents budgétaires fédéraux de mars 1996, une hausse de 1 % du PIB réel réduit le déficit d’environ 1,5 milliard de dollars en moyenne. Une baisse des taux d’intérêt de 100 points de base (1 %) réduit le déficit de 2,3 milliards en moyenne sur quatre ans, l’impact augmentant avec le passage du temps à mesure que la dette vient à échéance. L’étude du budget doit donc pouvoir identifier la variation du solde budgétaire qui est attribuable au cycle des affaires et celle qui est due à la politique économique.
Ainsi, pour interpréter correctement la politique budgétaire du gouvernement, le solde budgétaire officiel est décomposé en deux parties: une composante conjoncturelle et une composante structurelle. La composante conjoncturelle est attribuable au cycle. La composante structurelle correspond au solde budgétaire corrigé de l’influence des variations cycliques sur les recettes et les dépenses budgétaires. C’est le solde budgétaire qui serait observé si l’économie se situait sur sa tendance de long terme. Étant libre de toute influence cyclique, il dépend essentiellement de la politique économique, dont il sert à identifier l’orientation et l’ampleur.
Le solde structurel permet aussi de jauger la situation financière du gouvernement, parce qu’il s’agit en quelque sorte du solde budgétaire permanent. Un déficit conjoncturel est un déficit temporaire occasionné par la faiblesse de l’activité économique. Il est appelé à se résorber de lui-même avec le retour de l’activité économique à un niveau "normal". Mais le solde structurel est permanent au sens où il persiste même dans des conditions économiques "normales". Il est dû au plan budgétaire plutôt qu’au cycle. Un déficit structurel implique que les taux d’imposition sont trop faibles pour financer les dépenses du gouvernement quand l’économie nationale fonctionne à sa "vitesse de croisière". Reste à déterminer si ce déficit permanent est soutenable. À cette fin, on soustrait du solde structurel les intérêts sur la dette pour obtenir le solde de fonctionnement structurel. Une situation financière non soutenable se caractérise par un ratio de la dette sur le PIB qui augmente sans fin. Cela risque de se produire quand le taux d’intérêt sur la dette est supérieur au taux de croissance de l’économie. Pour stabiliser le ratio de sa dette au PIB, le gouvernement doit réaliser un surplus de fonctionnement égal, en proportion de la dette en cours, à la différence entre le taux d’intérêt sur la dette et le taux de croissance nominale de l’économie. Voilà une règle simple utilisable pour déterminer si l’effort d’assainissement des finances publiques est adéquat. |
exprime souvent la dette d’un ménage en proportion de son revenu annuel pour mieux en saisir l’ampleur, on mesure la dette publique en proportion de l’ensemble des revenus générés dans l’économie. La situation financière d’un gouvernement est insoutenable quand le ratio de la dette publique au PIB est appelé à croître indéfiniment.
Lorsque la dette augmente plus rapidement que le PIB, les intérêts sur la dette augmentent plus rapidement que les recettes fiscales du gouvernement, à moins que celui-ci ne décide d’augmenter le fardeau fiscal de ses citoyens. De toute évidence, le taux d’imposition n’est pas élastique à l’infini. Que ce soit pour des raisons de compétitivité fiscale, pour éviter l’apparition de comportements socialement répréhensibles comme le travail au noir ou l’évasion fiscale, le fardeau fiscal ne peut augmenter sans fin. Il est donc clair que le gouvernement dont la politique budgétaire permet un accroissement continu du ratio de la dette au PIB se dirige vers une situation d’insolvabilité. Cela correspond exactement à la situation dans laquelle se sont trouvés le gouvernement fédéral et bon nombre de provinces à partir du milieu des années 80. Cette situation est bien illustrée à la figure 4 qui montre l’évolution du ratio de la dette au PIB de l’ensemble des administrations publiques canadiennes.
Figure 4
Évolution du ratio dette/PIB (1979-1995)
(en pourcentage)
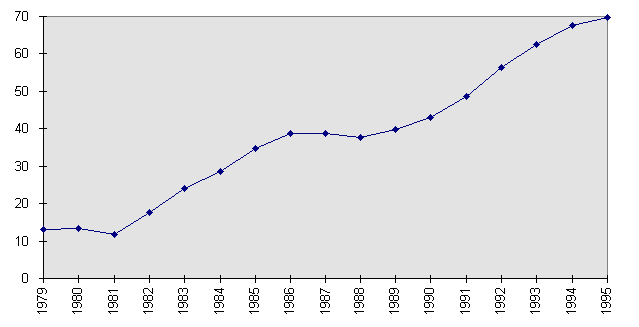
Un œil sur les taux d’intérêt et l’autre sur la croissance économique
Pour mieux comprendre les variables de l’environnement économique qui affectent cette dynamique d’insolvabilité, il est utile de diviser le déficit en deux parties : le déficit de fonctionnement et le service de la dette.
La dette publique augmente chaque année d’un montant égal au déficit de fonctionnement (aussi appelé déficit primaire) augmenté des intérêts sur la dette. Le déficit de fonctionnement est égal à la différence entre les dépenses de programme et les recettes courantes du gouvernement. Quand le solde de fonctionnement est nul, les recettes couvrent exactement les dépenses de programme et le déficit est égal aux intérêts sur la dette. L’augmentation de la dette est alors égale aux intérêts sur la dette. En comparant le taux d’intérêt sur la dette au taux de croissance du PIB, on peut savoir si la dette croîtra plus ou moins rapidement que le PIB (figure 5).
Lorsque le taux d’intérêt est plus faible que le taux de croissance du PIB, la dette publique augmente moins vite que la capacité de taxer du gouvernement et le gouvernement peut se permettre d’emprunter pour financer des dépenses de programme. En revanche, quand le taux d’intérêt est plus grand que le taux de croissance, la dette croît plus vite que le PIB et le ratio dette/PIB augmente sans fin. Depuis le début des années 80, l’environnement économique a été caractérisé par des taux de croissance faibles et des taux d’intérêt élevés : c’est un environnement propice à l’explosion du ratio de la dette. Devant la perspective d’une telle explosion, les marchés financiers n’ont pas caché leur impatience et les gouvernements n’ont eu d’autre choix que de passer à l’action. Depuis lors, les budgets austères se succèdent. En comparant les figures 4 et 5, on constate aisément que le ratio de la dette au PIB s’est mis à augmenter rapidement au moment où le taux d’intérêt sur la dette a dépassé le taux de croissance de l’économie.
Les déficits chroniques sont une source de préoccupation pour une autre raison. Dans une perspective de long terme, ils tendent à réduire la croissance d’une économie. Tout déficit budgétaire doit se financer. Dans la mesure où l’épargne disponible sert à financer un déficit gouvernemental, elle ne peut pas financer les projets d’investissement privés. La ponction exercée par les déficits budgétaires sur les marchés financiers tend à faire augmenter les taux d’intérêt et à décourager l’investissement privé. Étant donné que la croissance d’une économie est étroitement liée à l’investissement, les déficits chroniques tendent à déprimer la croissance de l’économie.
Figure 5
Taux de croissance du PIB nominal et taux d’intérêt moyen sur la dette
(1970-1996)
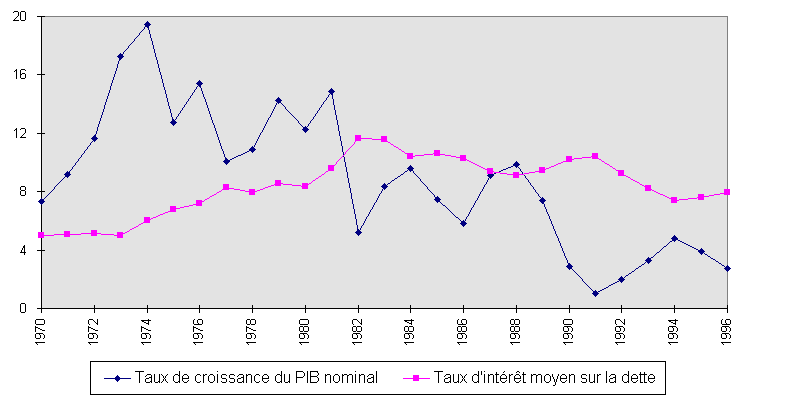
Le Canada n’est pas un cas isolé
À quelques exceptions près, la plupart des pays industrialisés sont aux prises avec des déficits budgétaires et une dette publique représentant une proportion significative de leur PIB. Ces pays vivent aussi à l’heure des compressions budgétaires et de la restructuration gouvernementale. C’est le cas en particulier des pays européens qui ont signé le Traité de Maastricht et qui se sont engagés à créer une monnaie unique après 1999. Pour faire partie du groupe, il faut satisfaire certaines conditions: le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3 % du PIB et le ratio dette/PIB est limité à un maximum de 60 %. Or, actuellement, même l’Allemagne n’est pas en mesure de remplir la première exigence, pas plus que la France d’ailleurs. On comprend mieux alors pourquoi tous ces pays ont entrepris un redressement sérieux de leurs finances publiques.
Au Canada comme au Québec, les gouvernements ont établi des plans budgétaires qui élimineront les déficits au tournant du siècle et qui permettront ainsi de stabiliser ou même de réduire le taux d’endettement public. Le gouvernement fédéral semble en bonne voie de réaliser ses objectifs et le gouvernement du Québec s’applique à y arriver. L’ajustement est pénible mais on perçoit la lumière au bout du tunnel.
Des choix difficiles
Il n’existe que deux façons d’assainir les finances publiques : augmenter les recettes et réduire les dépenses. Le niveau des impôts et des taxes étant déjà fort élevé au Canada (surtout en comparaison avec les États-Unis), beaucoup d’analystes croient que la solution passe par la réduction des dépenses. Il n’y a là rien de facile.
Environ la moitié des dépenses publiques est composée de paiements de transfert et des intérêts sur la dette. Plus on s’élève dans la structure gouvernementale, plus les paiements de transfert sont importants. Au fédéral, l’essentiel du budget est composé de transferts, le poste le plus important étant le service de la dette. C’est une dépense non directement contrôlable, une dépense incompressible sauf évolution favorable des taux d’intérêt. Les autres dépenses fédérales importantes sont les transferts aux personnes (comme les pensions de vieillesse) et les transferts aux provinces. La lutte au déficit fédéral passe donc obligatoirement par une réforme de ces transferts.
Les conséquences sont immédiates sur les finances publiques provinciales. L’assainissement des finances provinciales requiert nécessairement des mesures en santé et en éducation, secteurs qui accaparent le gros du budget. Cela ne signifie pas que les autres postes de dépense sont à l’abri. Toute dépense doit être revue pour déterminer si elle mérite d’être maintenue. Toutes les avenues doivent être explorées et tous les secteurs mis à contribution. Mais le potentiel d’économies budgétaires est évidemment plus important là où les dépenses sont les plus élevées.
De plus, dans le contexte budgétaire actuel, les entreprises doivent s’attendre à ce que l’aide gouvernementale leur soit fournie au compte-gouttes. Toute intervention publique justifiée risque de prendre la forme d’une réglementation plutôt que d’une dépense publique, la réglementation ayant l’avantage d’être peu coûteuse pour les gouvernements.
Peut-être y a-t-il encore quelques avenues à explorer du côté des recettes. Mais il ne faut pas croire qu’on peut combler les déficits budgétaires en faisant payer les "autres", c’est-à-dire les riches et les sociétés. En définitive, ce sont toujours des personnes qui paient les impôts. Ce ne sont pas des compagnies impersonnelles qui supportent en bout de ligne l’impôt sur les bénéfices des sociétés, ce sont des personnes, qu’elles soient actionnaires, employées ou clientes de ces sociétés. N’oublions pas que les caisses de retraite sont des actionnaires importants.
Chaque poste du budget a commencé à faire l’objet d’un examen poussé pour déceler les économies possibles et les sources de financement additionnel. La privatisation d’entreprises publiques n’est pas une véritable solution : elle n’améliore pas le bilan de l’État puisqu’elle consiste à vendre des actifs pour réduire la dette. Elle peut toutefois se justifier sur une base de rationalisation et d’efficacité des activités. À cet égard, la sous-traitance est une option à explorer. Dans le même ordre d’idées, la tarification des services publics est une avenue prometteuse, avec des réserves évidentes dans le domaine de la santé et de l’éducation primaire et secondaire. C’est au niveau municipal, où la part budgétaire attribuée aux services publics est la plus grande, que la tarification offre le plus de possibilités. En principe, il est toujours préférable de faire payer l’usager, le bénéficiaire des services publics, plutôt que le contribuable. Ce principe se défend à la fois sur le plan de la justice et de l’efficacité. La tarification pourrait prendre une forme inattendue et quasi fiscale. Par exemple, la lutte à la pollution se fait souvent par la voie de la réglementation. Elle pourrait se faire au moyen de taxes vertes ou encore de droits de pollution. Elle serait alors une source de recettes additionnelles pour les gouvernements concernés.
Au-delà de l’an 2000
En supposant que nos gouvernements atteignent les cibles budgétaires qu’ils se sont fixées, la prochaine décennie sera fort différente de celle qui s’achève. La fin des compressions budgétaires à répétition permettra sans doute à l’économie canadienne de croître à un rythme voisin de son potentiel. Il y a aussi fort à parier que l’écart entre les taux d’intérêt canadiens et américains se maintiendra à un niveau beaucoup plus faible qu’au début des années 90.
Par ailleurs, l’obsession de la lutte au déficit risque d’être remplacée par un débat beaucoup plus nuancé sur le rôle du gouvernement dans l’économie. La question du fardeau fiscal des particuliers sera fort probablement en tête de liste de ce débat. Mais, en même temps, de nombreuses voix se feront entendre en faveur d’un réinvestissement dans certains programmes gouvernementaux. Ce qui semble certain cependant, c’est que l’ère de l’intervention à tout crin est révolue.
Plutôt que d’orienter l’activité économique, le rôle des gouvernements consistera à maintenir un environnement économique, financier, politique et juridique stable et à fournir l’encadrement nécessaire au fonctionnement harmonieux des marchés. C’est déjà tout un programme, n’en exigeons pas davantage. D’ailleurs, un sain réalisme est de mise quant à la capacité de nos gouvernements d’influer de façon utile sur le cours de l’économie à l’heure de la mondialisation.