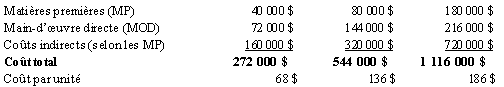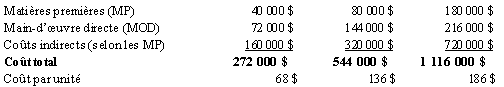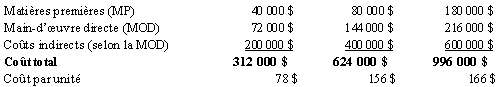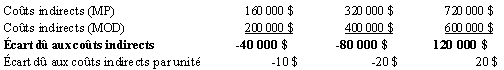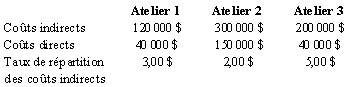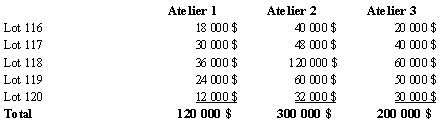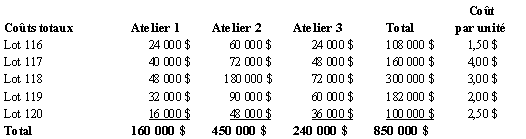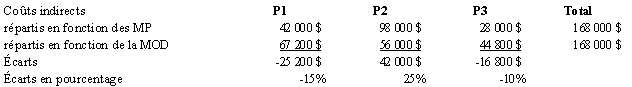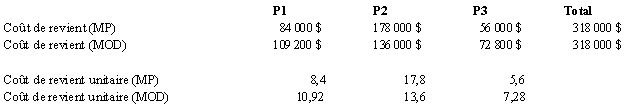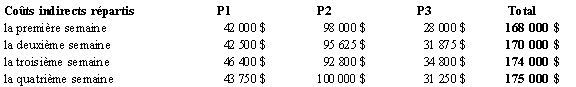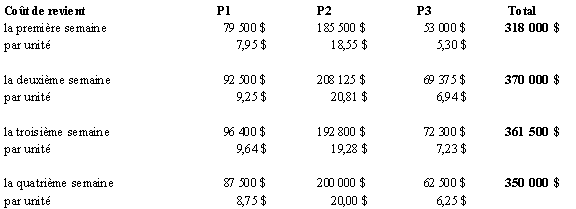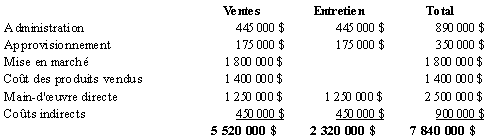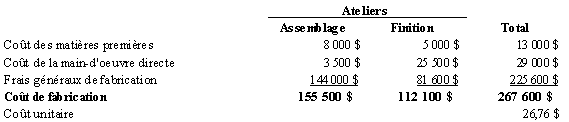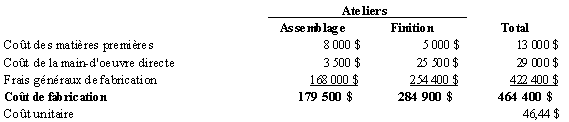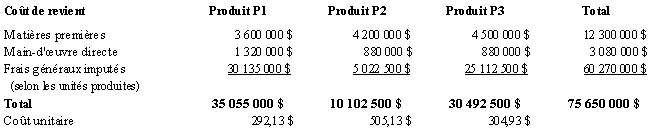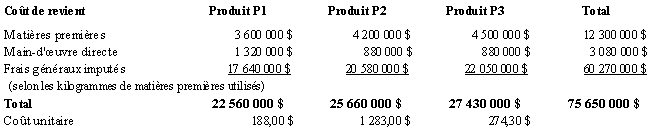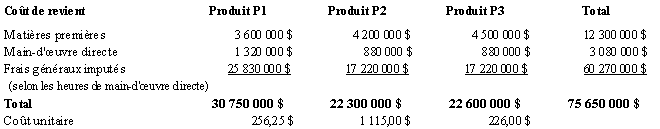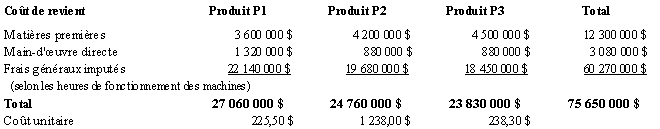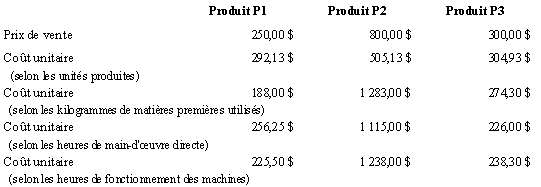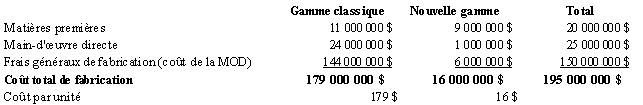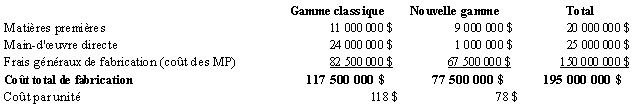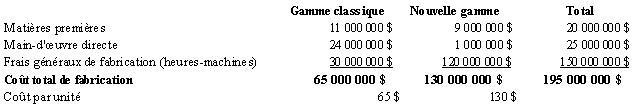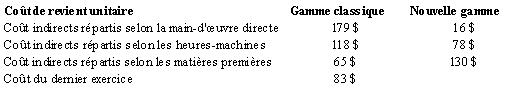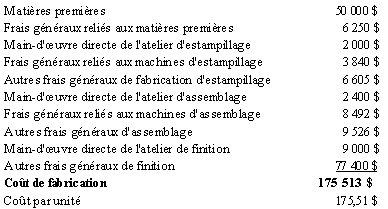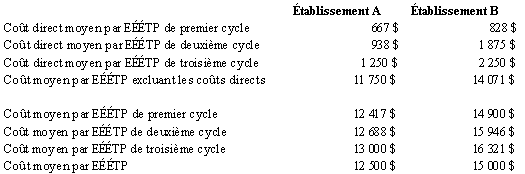Chapitre
4
Les
coûts indirects et les centres de coût
Objectifs
Après avoir étudié
ce chapitre, vous serez capable :
-
de comprendre la nécessité
de tenir compte des coûts indirects dans le calcul des coûts
de revient;
-
de répartir les frais généraux
ou de les imputer;
-
de discuter du choix de la base d’imputation;
-
de comprendre le rôle que jouent
les centres de coût dans l’allocation des coûts indirects;
-
de calculer les coûts de revient
constitués en partie de coûts indirects;
-
de tenir compte, dans la prise de décision,
des coûts indirects composant les coût de revient.
Comprendre la nécessité
de tenir compte des coûts indirects
Dans l’entreprise manufacturière
moderne, les coûts indirects représentent souvent plus de
80 % des coûts de transformation. On ne pourrait prétendre
calculer des coûts de revient si on ignorait les coûts indirects.
Répartir les frais généraux
ou les imputer
Diverses méthodes sont utilisées
par les entreprises pour répartir les frais généraux
ou les imputer. Ces méthodes déterminent l’interprétation
qu’il faut donner aux résultats obtenus. Il est important de bien
saisir la mécanique de ces méthodes pour interpréter
correctement les coûts de revient obtenus. Ces derniers déterminent
la rentabilité des produits et services.
Discuter du choix de la base d’imputation
Comme le résultat (coût
de revient obtenu) dépend des choix concernant la répartition
et l’imputation des coûts indirects, cette question est fondamentale.
Comprendre le rôle que jouent
les centres de coût dans l’allocation des coûts indirects
Les centres de coûts sont des
lieux où l’on accumule les coûts indirects avant de les répartir
ou de les imputer aux produits et aux services. Leur rôle est crucial
dans l’effort de rattachement des coûts aux produits et services
qui contribuent à les engendrer.
Calculer des coûts de revient
Par cet objectif, on intégrera
la matière des chapitres 3 et 4.
Tenir compte, dans la prise de
décision, des coûts indirects
Par cet objectif, on situera le chapitre
4 dans la partie 1 de cet ouvrage, soit l’information financière
pour la prise de décisions.
Questions
de révision
-
Les coûts indirects sont rattachés
à des ressources qui servent à la production de plusieurs
biens et services.
-
La maintenance et la supervision sont
des exemples de coûts indirects reliés à la fabrication
alors que la publicité et la supervision d’une équipe de
vendeurs sont des exemples de coûts indirects reliés à
la vente. Par ailleurs, les coûts d’administration sont généralement
tous indirectement reliés à l’activité de l’entreprise.
-
Ces deux règles sont :
a) le coût de toutes les ressources
consommées au cours d’un exercice est distribué entre les
extrants;
b) les coûts indirects sont
répartis au prorata du volume des extrants.
-
Parce qu’un objectif même de la
comptabilité financière est de renseigner les tiers sur les
ressources consommées et les produits fabriqués au cours
d’une période donnée.
-
Parce qu’il semble logique de distribuer
les coûts indirects engagés au cours d’une période
de manière équivalente entre tous les produits issus de cette
période.
-
Le coût indirect par unité
est fonction du montant total des coûts indirects et du nombre total
d’extrants issus de la même période.
-
Un centre de coûts est un endroit
où l’on engage et accumule des coûts.
-
Il arrive qu’on regroupe les coûts
indirects par centres de coûts pour les répartir plus fidèlement
par la suite.
-
Oui, lorsqu’on utilise différentes
bases de répartition qui, bien que toutes proportionnelles au volume
d’extrants, ne présentent pas la même consommation de ressources
relativement aux produits et aux services.
-
Oui, lorsqu’on accumule les coûts
dans des centres de coûts avant de les répartir entre les
produits et les services, on procède en deux étapes.
-
L’imputation sert à attacher
un montant de coûts indirects aux produits et aux services avant
même de connaître les coûts indirects réels.
-
Les éléments nécessaires
à la détermination d’un taux d’imputation sont :
-
un budget prévoyant les coûts
indirects que l’entreprise devra assumer;
-
une prévision du volume d’extrants
issus de l’activité de production.
-
Elles sont toutes proportionnelles au
volume d’extrants ou volumiques.
-
On suggère de choisir une base
qui reflète le mieux la consommation des ressources indirectes par
les activités alors que, par définition, il n’existe pas
de relation entre le volume des extrants et les coûts indirects.
-
Voici cinq bases d’imputation fréquemment
utilisées : les heures de main-d’œuvre directe, le coût de
la main-d’œuvre directe, les quantités de matières premières,
le coût des matières premières et les heures-machines.
-
Sous-imputation désigne l’écart
entre les frais imputés et les frais réels lorsque les premiers
sont inférieurs aux seconds. Surimputation désigne l’écart
entre les frais imputés et les frais réels lorsque les premiers
sont supérieurs aux seconds.
-
On peut les fermer au compte Résultats,
au compte Coût des produits vendus ou encore les répartir
entre les comptes Coût des produits vendus, Stock des produits finis
et Stock des produits en cours.
-
À moyen et à long terme,
l’entreprise doit couvrir tous ses coûts, y compris ses coûts
indirects. Il est donc important de bien les évaluer.
19. Les activités qui engendrent
les coûts indirects servent à produire les biens et les services,
ils sont même essentiels. En conséquence, il apparaît
important de les prendre en considération pour évaluer la
rentabilité de ces biens et de ces services, sinon la rentabilité
sera surévaluée.
20. Cette règle pourrait mener
à des décisions malheureuses dans les cas où il y
a des capacités inutilisées ou excédentaires. En effet,
la direction pourrait être tentée de faire assumer les coûts
liés à ces capacités par l’ensemble de la production
et ainsi sous-estimer la véritable rentabilité de ses produits.
Exercices
Exercice 4.1 Répartition
des coûts indirects
En répartissant le montant
des coûts indirects au prorata du coût des matières
premières, on obtient, pour chacun des produits, le coût de
revient suivant :
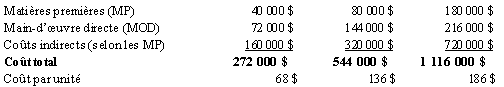
En répartissant le montant
des coûts indirects au prorata du coût de la main-d’œuvre directe,
le coût de revient de chacun des produits est le suivant :
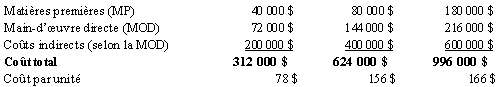
Les écarts entre les deux
modes de répartition des coûts indirects sont les suivants
:
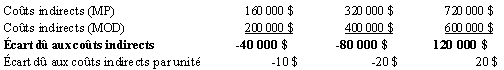
Exercice 4.2 Répartition
des coûts indirects par le biais des centres de coûts
Pour obtenir le coût de revient
d’un lot, il faut d’abord répartir les coûts indirects accumulés
dans les ateliers entre les lots au prorata des coûts directs de
chacun. Le tableau qui suit établit le taux de répartition
des coûts indirects par atelier.
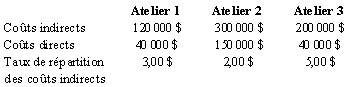
Le tableau qui suit présente
les coûts indirects répartis entre les lots.
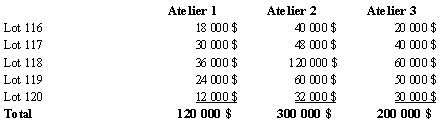
Le tableau qui suit présente
le coût total de chacun des lots ainsi que le coût par unité.
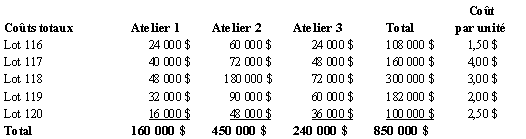
Exercice 4.3 Analyse des coûts
indirects répartis
Le tableau qui suit répond
aux trois premières questions de l’exercice.
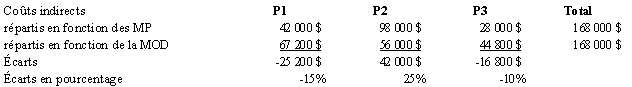
Le tableau suivant présente
les coûts de revient lorsqu’on répartit les coûts indirects
en fonction des matières premières et en fonction de la main-d’œuvre
directe.
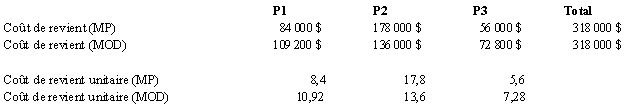
4. En principe, nous devons prendre
le facteur qui explique le mieux la variation des coûts indirects.
Or, ni l’un, ni l’autre n’explique véritablement les frais généraux.
Toutefois, le coût total des matières premières est
de 120 000 $, soit quatre fois plus élevé que celui de la
main-d’œuvre directe qui est de 30 000 $. Pour cette raison, nous favorisons
le coût des matières premières comme base de répartition
des coûts indirects.
Exercice 4.4 Analyse des coûts
indirects répartis
1. Les coûts indirects répartis
entre les produits au prorata des coûts des matières premières
sont présentés dans le tableau suivant.
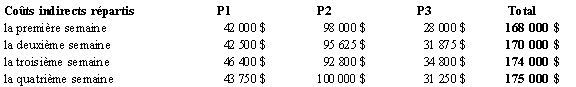 2. Le coût de revient par
unité pour chacune des quatre semaines est établi dans le
tableau qui suit.
2. Le coût de revient par
unité pour chacune des quatre semaines est établi dans le
tableau qui suit.
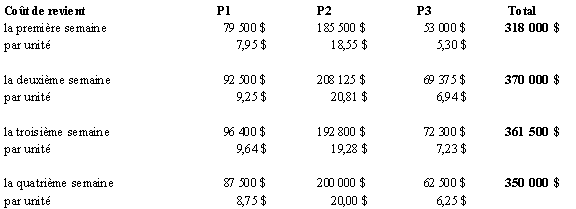
3. Deux paramètres expliquent
les variations du coût de revient d’une semaine à l’autre,
le montant total des coûts indirects, qui varie de 168 000 $ à
175 000 $, et le coût total des matières premières,
qui sert à répartir les coûts indirects et qui varie
également d’une semaine à l’autre de 120 000 $ à 160
000 $.
4. Ces variations ne devraient
pas influer sur le prix de vente des produits; elles ne devraient pas modifier
l’évaluation des stocks de produits finis. L’imputation permet d’obtenir
un coût de revient uniforme en ce qui concerne les coûts indirects.
5. En principe, nous devons prendre
le facteur qui explique le mieux la variation des coûts indirects.
Or, aucun facteur n’explique véritablement les frais généraux.
Toutefois, le coût total des matières premières représente
80 % des coûts directs. Pour cette raison, nous favorisons le coût
des matières premières comme base de répartition des
coûts indirects.
Exercice 4.5 Détermination
du taux d’imputation
-
4,00 $ par unité;
-
2,00 $ par dollar de matières
premières;
-
8,00 $ par kilogramme de matières
premières;
-
0,80 $ par dollar de main-d’œuvre directe;
-
5,12 $ par heure de main-d’œuvre directe;
-
12,80 $ par heure de fonctionnement
des machines.
Exercice 4.6 Imputation des frais
généraux de fabrication
-
L’impact sur le coût de revient
serait une augmentation de 20 $ par unité,
soit 6 800 000 $/340 000.
-
Cette augmentation ferait passer le
coût de revient de 270 $ à 290 $ par unité, ce qui
n’est pas négligeable. Ne pas le considérer serait communiquer
une mauvaise image de la véritable rentabilité de l’entreprise.
Exercice 4.7 Détermination
de la sous-imputation mensuelle
Le taux d’imputation est de 200 $
l’heure, soit 60 000 000 $/300 000 heures.
Au cours du mois de novembre, on
a imputé 4 400 000 $, c’est-à-dire 22 000 heures à
200 $ l’heure.
Il y a donc eu une sous-imputation
de 800 000 $, c’est-à-dire 5 200 000 $ - 4 400 000 $.
Exercice 4.8 Imputation des frais
généraux de fabrication
Le taux d’imputation est de 3 $ par
dollar de matières premières, soit 12 000 000 $/4 000 000
$.
Au cours de l’année, on a
imputé 12 300 000 $, c’est-à-dire 4 100 000 $ de matières
premières à 3 $ par dollar.
Il y a donc eu une surimputation
de 200 000 $, c’est-à-dire 12 100 000 $ - 12 300 000 $.
Exercice 4.9 Imputation des frais
généraux de fabrication
Le taux d’imputation est de 20 $
l’heure, soit 8 000 000 $/400 000 heures.
Au cours du mois de septembre, on
a imputé 700 000 $, c’est-à-dire 35 000 heures à 20
$ l’heure.
Il y a donc eu une surimputation
de 100 000 $, c’est-à-dire 600 000 $ - 700 000 $.
Exercice 4.10 Réflexion
sur l’imputation
L’imputation est faite au prorata
du coût de la main-d’œuvre directe, de sorte que la commande no
13 supporte beaucoup plus de frais généraux que la commande
no 11 bien que cette dernière nécessite moins
de matières premières que la commande no 13. On
est porté à se demander s’il est justifié de faire
assumer les frais généraux par les commandes au prorata du
coût de la main-d’œuvre directe. La recherche d’une base plus appropriée
serait souhaitable.
Exercice 4.11 Répartition
des coûts indirects
-
Administration et bâtiments
: ces coûts semblent communs aux deux catégories de
produits de sorte que toute règle de répartition est arbitraire.
Dans ce cas, nous privilégions la règle logique qui est au
prorata des heures des techniciens,.
Approvisionnement : il faudrait
répartir les coûts d’approvisionnement au prorata du temps
du personnel travaillant à l’approvisionnement des deux types de
stocks. Nous n’avons pas cette information. Nous utiliserons encore une
fois les heures des techniciens.
Mise en marché : il
semble que cette activité ne concerne que les appareils neufs. Dans
ce cas, le montant de cette activité sera affecté en entier
à la vente et à l’installation des appareils neufs.
Coût des produits vendus
: ce montant se rapporte en entier aux appareils neufs
Main-d’œuvre directe
: 50 % (40 % + 10 %) se rapporte à
la vente d’appareils et 50 % à l’entretien et à la réparation
d’appareils existants.
Coûts indirects d’exploitation
: comme nous n’avons pas d’information précise sur leur partage,
nous privilégions la règle du partage au prorata des heures
des techniciens.
-
Le coût de revient des deux produits
offerts par l’entreprise est présenté dans le tableau qui
suit.
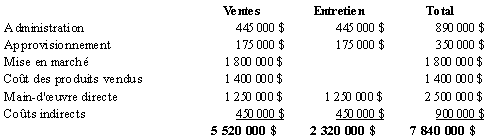
Exercice 4.12 Imputation par
centres de coûts
1. Le tableau qui suit présente
le coût de revient du lot no 4 en imputant les frais généraux
de fabrication de l’atelier d’assemblage en fonction des heures-machines,
ainsi que les frais généraux de fabrication de l’atelier
de finition en fonction des heures de main-d’œuvre directe.
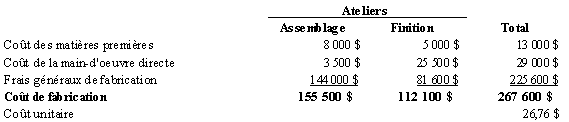
2. Le tableau qui suit présente
le coût de revient du lot no 4 en imputant les frais généraux
de fabrication de l’atelier d’assemblage en fonction des heures de main-d’œuvre
directe, ainsi que les frais généraux de fabrication de l’atelier
de finition en fonction des heures-machines.
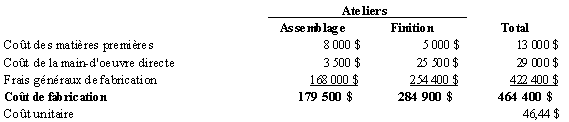
-
Il y a exactement 19,68 $ d’écart
entre les deux coûts calculés 26,76 $ et 46,44 $; ce qui est
énorme compte tenu du montant de 26,76 $. Le lot no 4
utilise 2,33 % des heures de main-d’œuvre directe et 2 % des heures-machines
à l’atelier d’assemblage ainsi que 0,96 % des heures de main-d’œuvre
directe et 3 % des heures-machines de l’atelier de finition. Selon la première
solution, le lot no 4 assume donc 2 % des frais généraux
de l’atelier d’assemblage et 0,96 % des frais généraux de
l’atelier de finition alors que dans la deuxième solution, le même
lot assume 2,33 % des frais généraux de l’atelier d’assemblage
et 3 % des frais généraux de l’atelier de finition.
Exercice 4.13 Calcul de la surimputation
ou de la sous-imputation
1. Le coût prévu de
la main-d’œuvre directe était de 6 500 000 $, c’est-à-dire
500 000 heures à 13 $.
Le taux d’imputation est donc de
5 $ par dollar de main-d’œuvre directe,
soit 32 500 000 $/6 500 000 $.
Le coût réel de la main-d’œuvre
directe a été de 6 625 000 $, soit 530 000 heures
à 12,50 $.
Le montant des frais généraux
imputés est alors de 33 125 000 $, soit 6 625 000 $ à 5 $
par dollar de main-d’œuvre directe.
La sous-imputation est de 575 000
$, soit 33 700 000 $ - 33 125 000 $.
2. Plusieurs facteurs interviennent
:
Exercice 4.14 Imputation et prix
de vente
1a) En imputant les frais généraux
de fabrication en fonction des unités fabriquées, on obtient
le coût de revient qui suit.
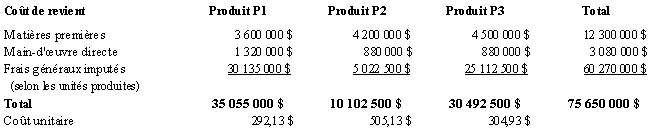
1b) En imputant les frais généraux
de fabrication en fonction des kilogrammes de matières premières,
on obtient le coût de revient qui suit.
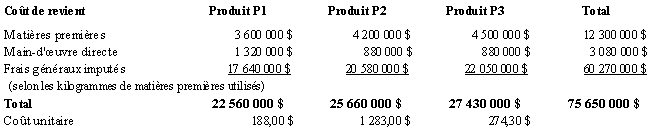
1c) En imputant les frais généraux
de fabrication en fonction des heures de main-d’œuvre directe, on obtient
le coût de revient qui suit.
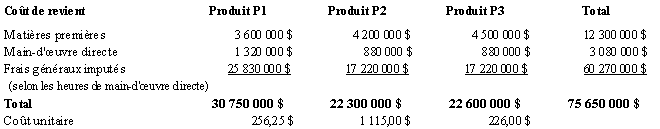
1d) En imputant les frais généraux
de fabrication en fonction des heures de marche des machines, on obtient
le coût de revient qui suit.
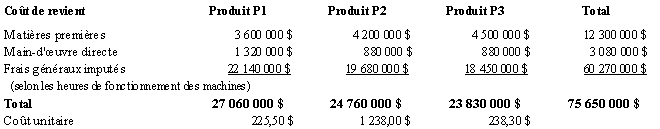
2. Le tableau qui suit montre les
écarts entre le coût de revient calculé en fonction
des différentes bases. Il devient évident que le choix de
la base d’imputation influe sur le coût des produits, et donc sur
la rentabilité calculée des mêmes produits.
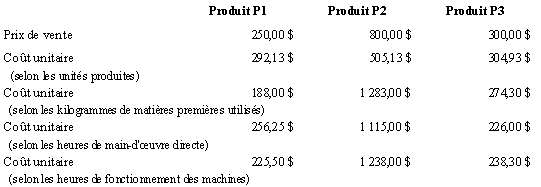
Exercice 4.15 Répartition
des coûts indirects et rentabilité des produits
1. Le
coût de fabrication prévu par unité des trois familles
de produits, à la suite des modifications apportées au procédé
d’assemblage des produits de la famille A se présente ainsi.
Les modifications apportées
au procédé d’assemblage vont réduire de 50% le coût
de la main-d’œuvre directe pour tous les produits de la famille A. Tous
les autres coûts demeurent les mêmes. Toutefois, la répartition
des 315 millions de coûts indirects de l’usine va changer parce que
le coût de la main-d’œuvre directe constitue la clé de répartition
de ces derniers. Voici la nouvelle fiche du coût de revient, incluant
les coûts indirects de l’usine.
| |
Famille A
|
Famille B
|
Famille C
|
| Matières
premières |
40,00 $
|
20,00 $
|
30,00 $
|
| Main-d’œuvre
directe |
10,00 $
|
15,00 $
|
15,00 $
|
| Coûts
indirects répartis |
35,00 $
|
52,50 $
|
52,50 $
|
| Coût
de fabrication |
85,00 $
|
87,50 $
|
97,50 $
|
Le tableau qui suit présente
le détail des calculs menant aux coûts indirects répartis:
| |
Famille A
|
Famille B
|
Famille C
|
Total
|
| Main-d’œuvre
directe |
10 $
|
15 $
|
15 $
|
|
| Main-d’œuvre
directe totale |
15 000 000 $
|
30 000 000 $
|
45 000 000 $
|
90 000 000 $
|
| Coûts
indirects totaux répartis |
52 500 000 $
|
105 000 000 $
|
157,500 000 $
|
315 000 000 $
|
| Coûts
indirects répartis à l’unité |
35,00 $
|
52,50 $
|
52,50 $
|
|
Le taux de répartition utilisé
a été 3,50 $/ $ de MOD, soit 315 000 000 $/90 000 000 $.
2. La formule actuelle de répartition
des coûts indirects a les avantages suivants :
-
elle répartit tous les coûts
indirects entre les trois objets de coûts;
-
elle le fait selon une formule qui reflète
le volume des extrants de chacun des objets de coûts;
Par ailleurs, elle présente
les inconvénients suivants :
-
elle ne reflète qu’une dimension
liée au volume des extrants, qui est le coût de la main-d’œuvre
directe (ou encore le temps de la main-d’œuvre directe si l’on suppose
que le taux payé est le même pour toute la main-d’œuvre) ;
-
elle a pour effet de répercuter
des changements au niveau de la production d’un seul objet de coûts
sur les autres objets de coûts.
Dans la situation actuelle, les
inconvénients l’emportent sur les avantages.
En effet, la répartition au
prorata du coût de la main-d’œuvre directe peut être acceptable
à la condition que les objets de coûts utilisent tous une
technologie qui fait appel de manière équivalente à
la main-d’œuvre directe. Dès qu’un objet parmi un ensemble d’objets
utilise une technologie différente de la technologie utilisée
par les autres objets, on vient de disqualifier toute clé de répartition,
reflet d’une technologie particulière. Dans le cas présent,
le produit A utilise dorénavant une technologie qui fait davantage
appel aux machines et moins à la main-d’œuvre alors que les produits
B et C utilisent toujours une technologie qui fait davantage appel à
la main-d’œuvre.
De plus, un deuxième principe
qu’on devrait respecter dans le choix d’une clé de répartition
des coûts indirects, est que les changements de méthode de
production d’un objet ne devraient pas avoir d’effets sur les coûts
indirects répartis aux objets de coûts qui ne sont pas touchés
par le changement. Or, dans la situation actuelle les produits des gammes
B et C voient leurs coûts s’accroître de façon substantielle,
ce qui devrait engendrer une réaction tout aussi vive que négative
de la part des directeurs des divisions B et C.
3. Le coût de revient global
par unité (incluant les coûts de toutes les ressources consommées)
en supposant que les coûts du siège social sont répartis
également entre les trois familles de produits, soit 1/3, 1/3 et
1/3 est présenté dans le tableau qui suit.
Au coût de fabrication, nous
devons ajouter les coûts spécifiques aux divisions ainsi que
les coûts du siège social.
| |
Famille A
|
Famille B
|
Famille C
|
Total
|
| Coût
de fabrication par unité |
85,00 $
|
87,50 $
|
97,50 $
|
|
| Coût
de fabrication total |
127 500 000 $
|
175 000 000 $
|
292 500 000 $
|
595 000 000 $
|
| Coût
de la division A |
30 000 000 $
|
|
|
30 000 000 $
|
| Coût
de la division B |
|
40 000 000 $
|
|
40 000 000 $
|
| Coût
de la division C |
|
|
60 000 000 $
|
60 000 000 $
|
| Coût
du siège social |
3 000 000 $
|
3 000 000 $
|
3 000 000 $
|
9 000 000 $
|
| Coût
total |
160 500 000
$
|
218 000 000
$
|
355 500 000
$
|
734 000 000
$
|
| Coût
total par unité |
107,00 $
|
109,00 $
|
118,50 $
|
|
Exercice 4.16 Répartition
des coûts indirects et rentabilité des produits
1. Les trois tableaux qui suivent
présentent le calcul du coût de revient de chacune des deux
gammes de produits en imputant les frais généraux de fabrication
-
au prorata du coût de la main-d’œuvre
directe;
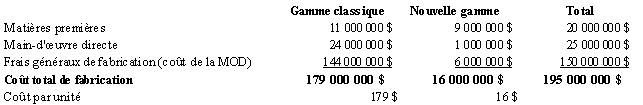
-
au prorata des heures-machines;
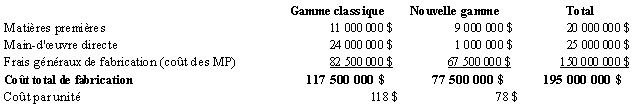
-
au prorata du coûts des matières
premières.
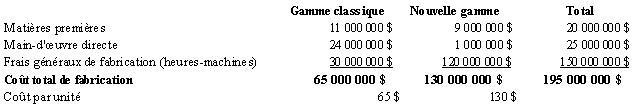
2. Le tableau qui suit compare
les coûts de revient pour la gamme classique selon les divers modes
de répartition des coûts indirects avec le coût de revient
du dernier exercice.
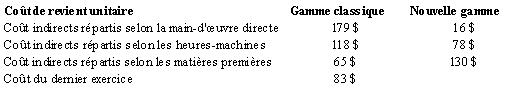
La production de la nouvelle
gamme engendre des coûts indirects élevés que doit
assumer la gamme classique lorsque ces derniers sont répartis en
fonction du coût de la main-d’œuvre directe ou encore des heures-machines.
Toutefois, le contraire se produit lorsque les coûts indirects sont
répartis au prorata du coût des matières premières.
Il faudrait analyser les coûts indirects afin d’établir des
liens entre ces derniers et les deux gammes de produits.
-
La répartition des coûts
indirects explique à elle seule l’écart entre les coûts
de revient obtenus.
-
La portion relativement élevée
des coûts indirects par rapport à l’ensemble des coûts
explique l’ampleur de l’écart. En effet, Les coûts indirects
représentent plus de 85 % des coûts de transformation soit
150 000 $/175 000 $, et près de 80 % des coûts totaux soit
150 000 $/195 000 $.
-
La consommation des matières
premières, de la main-d’œuvre directe et des heures-machines varie
beaucoup d’un produit à l’autre. Le modèle A consomme beaucoup
de main-d’œuvre directe alors que le modèle B est fortement automatisé.
Enfin, les deux consomment à peu près pour le même
montant de matières premières.
-
La seule façon d’obtenir un coût
de revient satisfaisant est de rattacher tous les coûts indirects
à des activités, puis d’établir l’utilisation des
activités par les objets de coûts afin de rattacher les coûts
des activités aux objets de coûts, comme dans la comptabilité
par activités.
Exercice 4.17 Répartition
des coûts indirects et centres de coûts
-
Le coût de revient du dernier
lot produit au cours du dernier exercice est le suivant :
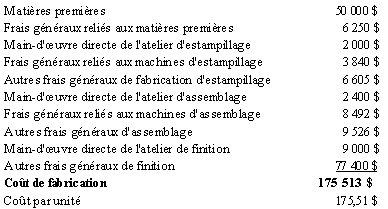
-
Les coûts sont dans un premier
temps accumulés par centres de coûts. Puis, dans un deuxième
temps, ils sont répartis au prorata de différentes bases
proportionnelles au volume d’extrants.
Exercice 4.18 Coûts indirects
dans une entreprise de services
1. Le tableau qui suit présente
divers calculs.
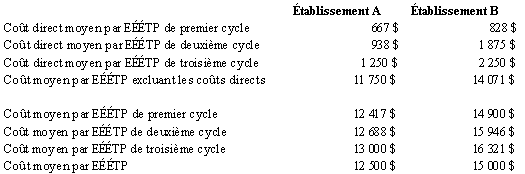 2. Nous avons supposé que tous
les coûts indirects, qui représentent respectivement 94% et
près de 94% des coûts totaux, sont répartis au prorata
du nombre de EÉÉTP. Les résultats nous démontrent
que le coût moyen par EÉÉTP, peu importe le cycle,
est plus élevé dans l’établissement B que dans l’établissement
A. Une analyse plus approfondie serait nécessaire afin de connaître
la cause de cette différence.
2. Nous avons supposé que tous
les coûts indirects, qui représentent respectivement 94% et
près de 94% des coûts totaux, sont répartis au prorata
du nombre de EÉÉTP. Les résultats nous démontrent
que le coût moyen par EÉÉTP, peu importe le cycle,
est plus élevé dans l’établissement B que dans l’établissement
A. Une analyse plus approfondie serait nécessaire afin de connaître
la cause de cette différence.
3. Il faudrait connaître les
activités auxquelles donnent lieu les coûts indirects et de
déterminer les clientèles étudiantes qui profitent
de ces mêmes activités.