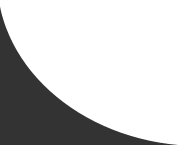 |
Gérer
l'ambiguïté de la complexité : comment neutraliser
le terrorisme des Jokers dans un monde sans Batman.
Publié
dans Le Devoir, 18 octobre 2001, page A6.
Après
la tragédie du World Trade Center et l'intervention militaire des
Américains en Afghanistan, nous sommes submergés par des
images de revanche et d'autres de défense. La revanche nous parle
d'armée, de missiles, de services secrets; la défense nous
invite à mettre nos masques à gaz, enfiler nos combinaisons
anti-chimique et fermer nos frontières. On sait qu'en cas de crise,
les humains utilisent la force et la fuite. Il existe cependant une troisième
stratégie : l'apprentissage et le changement en profondeur. Cette
stratégie part du principe que tout événement, même
tragique, est riche d'enseignement. Non pas des enseignements pour seulement
mieux utiliser la force ou mieux préparer la fuite. Mais des enseignements
pour vivre mieux, pour tenter d'éviter dans le futur de telles
tragédies.
La
stratégie de la force part du principe que la cause de nos malheurs
est extérieure à nous-mêmes et tente d'éliminer
cette cause. D'où la déclaration de guerre au terrorisme.
Cette stratégie est bien évidemment légitime. Les
terroristes doivent être traduits en justice et neutralisés.
Mais cette stratégie n'est que partielle. On connaît, par
exemple, les résultats mitigés de la guerre contre la drogue,
déclarée par le président Bush père.
La stratégie de la fuite part du principe que l'on ne peut anticiper
de telles tragédies et, donc, que l'on ne peut que se préparer.
Bien sûr, on invoque, comme signe avant-coureur, les kamikazes de
Pearl Harbor. Mais cette autre tragédie reste militaire, utilisant
des avions de guerre contre des bâtiments de guerre. Impensable
donc l'attaque du World Trade Center ? Non pas si on est lecteur de science
fiction. En 1940, Bob Kane, créateur du super-héros Batman,
avait anticipé un scénario similaire. Le personnage du Joker,
immortalisé à l'écran par Jack Nicholson, rendait
un poison opérationnel par le mixage de produits génériques,
comme du rouge à lèvre et de la poudre à bébé.
Les terroristes ont utilisé une stratégie similaire. Ils
ont rendu opérationnelle leur haine par le mixage de deux produits
génériques, des avions de ligne et des tours à bureaux.
Leur stratégie n'était certainement pas impensable; elle
était surtout, malheureusement, trop bien pensée ! Comme
le Joker, expert en chimie, ces terroristes sont des experts en théorie
des systèmes. Ils savent que la complexité a deux côtés:
un côté producteur, permettant plus de vitesse et d'efficience
à grande échelle; et un côté destructeur, rendant
possible l'émergence rapide de catastrophes massives. Toutes nos
innovations complexes ont ce caractère ambiguë : nos systèmes
informatiques, la biotechnologie, l'aviation, l'énergie nucléaire.
Ces innovations sont vulnérables aux variations climatiques (déluge
du Saguenay, tempête du verglas) et aux erreurs humaines (Chernobyl,
Bhopal, Exxon Valdez). Le terrorisme est un cas particulier réellement
terrifiant : des fanatiques exploitent de façon stratégique
le côté noir de cette complexité ! Dans le cas du
World Trade Center, ils ont exploité de façon délibérée
le potentiel destructeur des avions de ligne et des tours à bureaux
à forte concentration humaine.
Bob Kane savait que le Joker n'était pas un criminel ordinaire,
mais un super-criminel; et il savait que celui qui pourrait le neutraliser
n'était pas seulement un héros : il fallait un super-héros
: Batman. On peut bien sur sourire à ce phantasme de toute puissance
ou même se dire que seuls les Américains y sont sensibles.
Ce serait oublier le Tintin Belge ou l'Astérix Français.
Ces personnages hors du commun nous invitent à nous dépasser.
Mais la tragédie de New York nous démontre que dans le monde
réel, seuls les Jokers existent vraiment, exploitant stratégiquement
nos faiblesses. Il nous faut donc nous dépasser et apprendre.
L'une
des leçons fondamentale à retenir de cette tragédie
est que nos pratiques de gestion, en entreprise privée et en administration
publique, sont trop unidimensionnelles. Que cela soit pour l'aviation
civile ou l'immobilier, notre monde est surtout dominé par des
impératif de performance et de rentabilité. Ces impératifs
nous poussent, par exemple, à refuser certaines pratiques de sécurité
dans l'aviation ou à bâtir des tours à bureaux gigantesques.
Elles nous poussent de même à accroître de façon
démesurée notre degré de complexité, car performant
et rentable, qui peut alors être exploité par des terroristes.
Estelle Morin des HEC a mesuré de façon rigoureuse la prédominance
de ces impératifs : plus de 76% de nos critères actuels
de l'efficacité organisationnelle sont de nature financière.
Seuls 24% touchent des considérations non financières comme
la sécurité, la santé au travail ou l'impact global
des organisations sur nos communautés et le monde en général.
Accorder une place plus importante à ces impératifs mènerait
à des stratégies nouvelles plus robustes à l'ambiguïté
de la complexité. Heureusement, ces stratégies ont déjà
été définies dans le domaine scientifique de la gestion
des risques et des crises . Ceci inclut :
- Rechercher
de façon systématique le côté potentiellement
destructeur de la complexité. La firme Johnson and Johnson par
exemple, après l'empoisonnement des capsules Tylenol, n'a pas
conclut qu'un acte terroriste contre ce produit était improbable.
Ils ont simulé délibérément des attaques
terroristes contre le Tylenol et modifié les caractéristiques
de ce produit et de son emballage.
- Accroître
l'impératif de la sécurité dans le design des produits.
Il est évident que le Pentagone, construit par des militaires
avec un soucis de sécurité, a mieux résisté
aux attentats. Ceci a des implications importantes pour le design d'ouvrages
aussi différents que des tours à bureaux, des barrages
ou des centrales nucléaires.
-
Diminuer le couplage entre les éléments d'un système.
La tempête du verglas, par exemple, nous a démontré
notre dépendance aux systèmes centralisés. Des
stratégies plus robustes incluent aussi, par exemple, l'utilisation
de mini-centrales plus près des communautés ou des systèmes
d'appoints individuels, comme des génératrices et des
feux à combustion lente.
-
Encourager une distribution éthique de la richesse. Sans insinuer
que cela soit une excuse, il semble évident que le fait que des
personnes gagnent moins de 1 dollar par jour encourage la violence.
Déjà les révolutionnaires français de 1789
criaient "risquons tout puisque nous avons rien".
-
Développer une véritable culture de sécurité
civile. Ceci inclut la capacité d'envisager, sans tomber dans
la paranoïa, le côté destructeur de la complexité
et de prémunir contre lui. Les tentatives actuelles de réduire
l'effet de serre, par exemple, vont dans ce sens. Aussi, en Nouvelle
Zélande, la population est préparée à se
prendre en main durant une durée de trois jours, dans l'avènement
d'une catastrophe.
-
Encourager l'apprentissage des crises majeures. Cette dernière
stratégie vise à tirer les leçons profondes de
l'émergence d'une crise. Dans le cas du World Trade Center, il
est impératif que nous apprenions à mieux tolérer
les différences culturelles et religieuses des peuples de la
terre, tout en neutralisant le terrorisme.
Paul
Tillich, le célèbre théologien, nous avait déjà
mis en garde au sujet des deux facettes de la complexité : "J'ai
la conviction", a-t-il déclaré en 1963 à des
gens d'affaires à New York, " que la caractéristique
de la condition humaine, tout comme celle de la vie en général,
est l'ambiguïté : ce mélange inséparable du
bien et du mal, du vrai et du faux, des forces créatrices et destructrices
- tant au niveau individuel que social [...] Celui ou celle qui n'est
pas conscient de l'ambiguïté de sa perfection, en tant que
personne et dans son travail, n'a pas encore atteint la maturité".
Dans notre monde complexe où Batman n'existe pas mais où
les Jokers sont bien réels et ne disparaîtrons pas de si
tôt, il est urgent que nous ne nous arrêtions pas aux seules
stratégies de la force et de la fuite. Nous nous devons de développer,
de plus, une autre maturité.
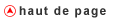
|
|